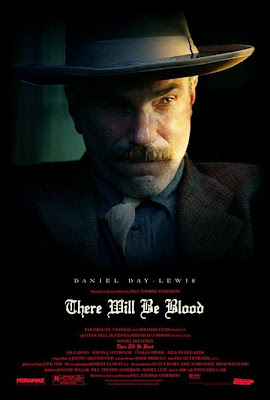Dixon Steele (Bogart) est un scénariste qui a connu son heure de gloire avant-guerre, et qui peine maintenant à rédiger ne serait-ce que le traitement de livres ineptes. Ses démons familiers (l'alcool un peu, la violence beaucoup) ont plombé sa carrière et ses amours.
Le meurtre d'une jeune fille, pour lequel Dixon est le principal suspect, lui fait rencontrer sa belle voisine Laurel Gray (Gloria Grahame) dont le témoignage l'innocente... mais le doute et la suspicion sont à l'œuvre.
La séquence d'ouverture (Bogart mâchoire crispée dans le rétroviseur, filant dans la nuit) est celle d'un film noir, et par bien des côtés Le violent en a les atours: personnages ambigus, enquête policière, femme somptueuse, ambiances nocturnes. Le moins que l'on puisse dire, pourtant, c'est que la résolution de l'énigme (qui a tué la fille du vestiaire, vue vivante pour la dernière fois avec Steele?) n'a pour Nicholas Ray que l'épaisseur d'un dispositif scénaristique destiné à rapprocher, puis à éloigner, son couple-vedette. Au contraire de l'histoire originale qui jouait l'ambiguïté pour ménager la révélation finale de l'identité du meurtrier, le film se concentre sur les ravages opérés par le manque de confiance et de communication sur les personnages, et la dissolution d'un couple (ou plutôt d'un rêve de couple) par-delà.
Car Dixon Steele et Laurel Gray ont ceci en commun d'être victimes de leurs pulsions respectives (le premier se jette à la gorge de qui le provoque, la seconde, actrice jamais vraiment "arrivée", semble s'accrocher maladivement à quiconque est susceptible de la mettre un peu plus dans la lumière d'Hollywood) et parce qu'ils échouent à les raisonner, à prendre des décisions qui leur fassent du bien, ils sont condamnés à faire périodiquement table rase et à tout recommencer de zéro. Aussi leur rencontre, dans le commissariat où Laurel innocente Dixon par son témoignage, ressemble-t-elle fort pour chacun d'eux à la dernière chance d'être compris et accepté pleinement par un autre, d'être sauvé de soi-même...
L'euphorie d'avoir trouvé le significant other nous est dépeinte comme une tranquille fusion des deux quotidiens en un seul, gouvernée par une complicité tacite, une tendresse mise en actes mais pas en paroles. Mutisme bienheureux (on sait que l'on s'aime, nul besoin de le dire) qui causera leur perte, car tout comme Dixon est incapable de s'excuser après une explosion de rage il ne sait pas énoncer simplement ses sentiments pour Laurel ni (au risque de s'incriminer à force de plaisanteries douteuses!) dissiper les ombres qui l'enserrent (tout comme l'enferment les innombrables grilles et barreaux de son appartement). De son côté Laurel ne saura pas davantage faire part de ses interrogations et, trop à l'écoute d'une fielleuse (sa masseuse) et d'une peureuse (l'épouse de l'inspecteur de police) et pas assez confiante en Dixon, elle précipitera la destruction de leur amour en accumulant les mensonges.

On ne peut pas totalement occulter le parallèle entre le naufrage dépeint par le film et la déroute, contemporaine de son tournage, du couple formé à la ville par Nicholas Ray et Gloria Grahame. La lourde tristesse de Bogart, l'amertume et la lassitude des deux anciens amants se séparant, trahis dans leur foi après y avoir cru si fort, tout ceci semble être le fruit d'observations désenchantées, transformées sur l'écran en éloge funèbre plein d'ironie.
Car Dixon Steele et Laurel Gray ont ceci en commun d'être victimes de leurs pulsions respectives (le premier se jette à la gorge de qui le provoque, la seconde, actrice jamais vraiment "arrivée", semble s'accrocher maladivement à quiconque est susceptible de la mettre un peu plus dans la lumière d'Hollywood) et parce qu'ils échouent à les raisonner, à prendre des décisions qui leur fassent du bien, ils sont condamnés à faire périodiquement table rase et à tout recommencer de zéro. Aussi leur rencontre, dans le commissariat où Laurel innocente Dixon par son témoignage, ressemble-t-elle fort pour chacun d'eux à la dernière chance d'être compris et accepté pleinement par un autre, d'être sauvé de soi-même...
L'euphorie d'avoir trouvé le significant other nous est dépeinte comme une tranquille fusion des deux quotidiens en un seul, gouvernée par une complicité tacite, une tendresse mise en actes mais pas en paroles. Mutisme bienheureux (on sait que l'on s'aime, nul besoin de le dire) qui causera leur perte, car tout comme Dixon est incapable de s'excuser après une explosion de rage il ne sait pas énoncer simplement ses sentiments pour Laurel ni (au risque de s'incriminer à force de plaisanteries douteuses!) dissiper les ombres qui l'enserrent (tout comme l'enferment les innombrables grilles et barreaux de son appartement). De son côté Laurel ne saura pas davantage faire part de ses interrogations et, trop à l'écoute d'une fielleuse (sa masseuse) et d'une peureuse (l'épouse de l'inspecteur de police) et pas assez confiante en Dixon, elle précipitera la destruction de leur amour en accumulant les mensonges.

On ne peut pas totalement occulter le parallèle entre le naufrage dépeint par le film et la déroute, contemporaine de son tournage, du couple formé à la ville par Nicholas Ray et Gloria Grahame. La lourde tristesse de Bogart, l'amertume et la lassitude des deux anciens amants se séparant, trahis dans leur foi après y avoir cru si fort, tout ceci semble être le fruit d'observations désenchantées, transformées sur l'écran en éloge funèbre plein d'ironie.